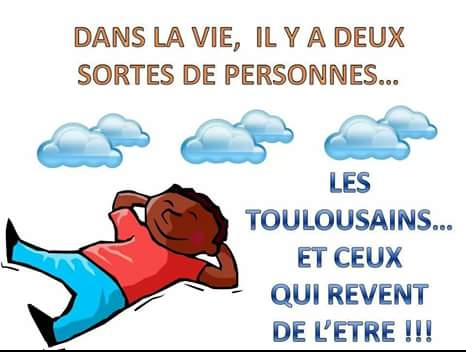L’idée de "ralentir" pourrait presque hérétique. Les dirigeants d’entreprise, pris dans un tourbillon d’e-mails, de réunions et de décisions à prendre, ont intégré l’idée qu’être réactif, disponible à tout moment et rapide dans l’exécution est la condition sine qua non du succès. Pourtant, un courant grandissant remet en cause ce dogme de l’urgence: le "slow management". Inspiré à la fois des neurosciences et de la philosophie du "slow movement", ce concept prône l’art de ménager des temps de pause et de réflexion stratégique pour, paradoxalement, gagner en efficacité.
Loin d’être une simple tendance de bien-être, le slow management s’appuie sur des études scientifiques récentes qui montrent que notre cerveau, saturé par le multitâche et la pression temporelle, fonctionne moins bien. Des entreprises pionnières en ont fait l’expérience: prendre le temps de ralentir leur processus de décision et de gestion leur a permis de gagner en créativité, en productivité et même en compétitivité.
LE CERVEAU SOUS PRESSION: QUAND LA VITESSE DEVIENT UN FREIN
Depuis une dizaine d’années, les neurosciences explorent les effets de la surcharge cognitive sur la prise de décision. John Sweller, chercheur en psychologie cognitive, a démontré que notre mémoire de travail est limitée: lorsqu’elle est saturée par trop d’informations simultanées, notre capacité de réflexion stratégique s’effondre.
Une étude de l’Université de Stanford (2019) est venue confirmer cette intuition: les individus pratiquant le multitâche numérique constant (passer d’un mail à une notification puis à une réunion) développent une attention plus fragile et une mémoire moins performante que ceux qui se concentrent sur une tâche unique. Dans un contexte de direction d’entreprise, cela signifie que l’obsession de la vitesse conduit à des décisions hâtives, parfois contre-productives.
Le Dr Etienne Koechlin, directeur du Laboratoire de neurosciences cognitives de l’ENS, rappellait d’ailleurs que " le cerveau humain n’est pas conçu pour maintenir une vigilance soutenue en permanence. Il fonctionne mieux lorsqu’il alterne entre phases d’effort et phases de récupération ". Autrement dit: la pause est loin d’être une perte de temps, elle est une condition de la performance.