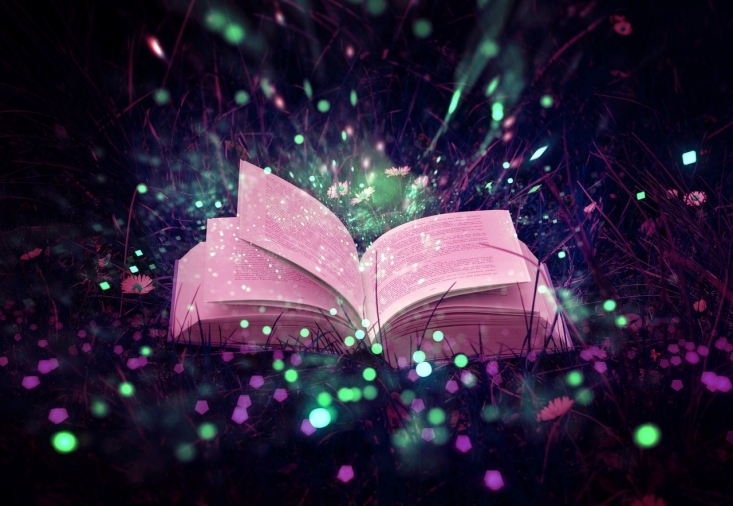Apprendre ne sert pas seulement à accumuler des connaissances; c’est surtout ce qui permet de penser par soi-même, écrit.
l’auteur: Robert Durocher - Enseignant de sciences au secondaire à la retraite, l’auteur a notamment publié "Enseigner avec passion" (Éditions Crescendo).
Chaque rentrée scolaire ramène la même interrogation dans la bouche de nombreux jeunes: "À quoi ça va me servir d’apprendre ça dans la vie?
"La question est légitime. Quand on est adolescent, il est difficile de percevoir l’utilité immédiate d’une règle de grammaire, d’un théorème mathématique ou d’un mot nouveau appris en classe. Pourtant, apprendre est bien plus qu’une contrainte scolaire: c’est un investissement dans son avenir, une manière de développer sa pensée critique et même de transformer son cerveau.
Les recherches en neurosciences le confirment: apprendre, c’est modifier l’architecture de notre cerveau. Chaque effort intellectuel active et renforce des réseaux de neurones, crée de nouvelles connexions et sculpte littéralement la matière grise. Ce processus, appelé neuroplasticité, prouve que le cerveau n’est pas figé. Il se façonne au gré des apprentissages, peu importe l’âge.
Un exemple frappant: les chauffeurs de taxi londoniens, qui mémorisent des milliers de rues, développent une région plus volumineuse de leur hippocampe, zone clé de la mémoire spatiale. D’autres études montrent que même apprendre à jongler ou à nommer de nouvelles couleurs entraîne des changements mesurables dans le cerveau. Bref, chaque apprentissage laisse une trace biologique.
Toutefois, apprendre ne sert pas seulement à accumuler des connaissances. C’est surtout ce qui permet de penser par soi-même. Dans un monde saturé d’informations, où les fausses nouvelles circulent aussi vite que les vraies, il devient vital de savoir comparer, douter, raisonner et analyser. Or, la pensée critique ne naît pas du néant: elle s’appuie sur des savoirs solides, construits au fil des lectures, des cours, des expériences. Plus on sait, plus on est capable de réfléchir avec autonomie et de se protéger des manipulations.
L’apprentissage est aussi une source de liberté intérieure. Chaque mot nouveau enrichit notre vocabulaire et nous donne une meilleure capacité à nous exprimer et à convaincre. Celui qui maîtrise la langue et les idées dispose d’un outil puissant pour se faire entendre et respecter. Dans une société où la communication est omniprésente, cette compétence devient essentielle.
Il ne faut pas oublier non plus que l’utilité d’un savoir n’est pas toujours immédiate. Une langue étrangère apprise au secondaire ou un raisonnement mathématique compris laborieusement peuvent devenir, 10 ans plus tard, la clé d’une rencontre, d’un emploi ou d’un projet. Les connaissances sont comme des graines: certaines germent vite, d’autres prennent du temps, mais toutes enrichissent le terreau de notre vie.
Enfin, apprendre nourrit la confiance en soi. Comprendre un texte difficile, résoudre un problème, mémoriser un poème: autant de petites victoires qui montrent qu’on est capable d’avancer. Et cette confiance, une fois acquise, devient un moteur puissant pour affronter les défis de demain.
Aux jeunes qui commencent une nouvelle année scolaire, j’aimerais lancer ce message: ne méprisez pas vos cours sous prétexte qu’ils vous semblent inutiles aujourd’hui. Chacun de vos apprentissages est un outil ajouté à votre coffre personnel. Vous ignorez encore lequel vous servira demain, mais soyez certains d’une chose: en apprenant, vous préparez bien plus qu’un examen, vous préparez votre vie.