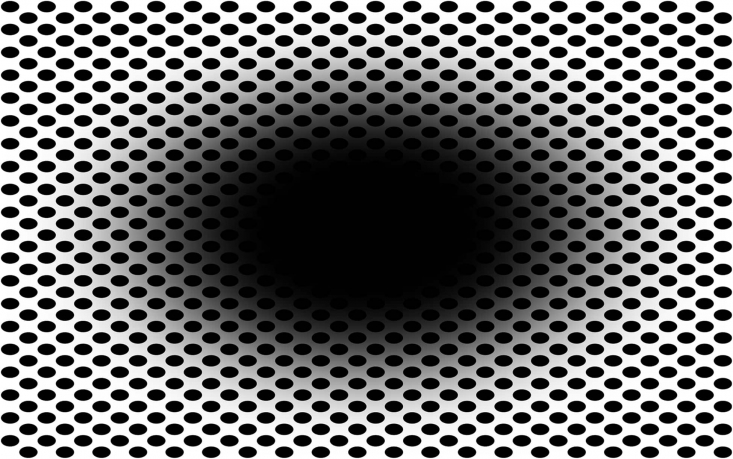Photo: Alain, 1959, Rome
L’égocentrisme est, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, une "déformation du moi, involontaire et inconsciente, consistant à n’envisager le point de vue ou l’intérêt des autres qu’à partir du sien propre".
Si l’on s’en tient à la stricte définition, difficile d’associer systématiquement l’usage de la 3e personne à une déformation telle que l’égocentrisme. Est-il cependant possible de l'assimiler à un "tic de langage"? Or, comme le documente Laélia Véron, il y a dans le tic de langage une dimension pathologique.
"On va encore dire de moi que je parle à la 3e personne… C’est vrai"., dit Delon en interview.
Mais chez l'acteur, l’usage de la 3e personne n’est pas systématique. Il est choisi et il témoigne d’une conscience linguistique plus profonde qu’il n’y paraît.
TROIS MANIÈRES DE COMPRENDRE L’USAGE DE LA 3ᵉ PERSONNE
C’est dans le contexte du film Borsalino and Co. que l’on en trouve la première mention: "Il y avait cinq ans que je voulais mettre Delon dans un film avec Belmondo", concède-t-il en parlant, de lui pour la première fois en public à la troisième personne. Et "Delon-producteur" de poursuivre:
"Je me disais: cela doit pouvoir se faire le public a envie de les voir ensemble, comme aux États-Unis on voit ensemble deux “monstres” style Gary Cooper–Burt Lancaster, Mitchum–Douglas ou, plus récemment, Paul Newman et Robert Redford [Butch Cassidy]. Mais personne ne trouvait de sujet".
Alain Delon parle de lui, et au lieu de dire Je/Moi, utilise "Alain Delon". Il a lui-même eu l’occasion de s’expliquer sur cet usage, et il disait notamment:
"Je ne suis pas quelqu’un qui a le culte du Moi. Je crois que dans la profession, il y a des confrères beaucoup plus en avance que moi sur le sujet".
Comment expliquer alors ces apparents paradoxes? La linguistique peut, de trois manières au moins, aider à comprendre cet usage de la 3e personne, et mieux cerner les enjeux: la valeur plus que le sens des mots, la subjectivité dans le langage, et l’énonciation.
LA VALEUR DES MOTS: UNE VISION VOLONTARISTE
La citation suivante est intéressante au regard de la subtilité entrevue dans l’épaisseur sémantique de certains mots employés par Alain Delon:
"Ma carrière n’a rien à voir avec le métier de comédien. Comédien, c’est une vocation. On veut être comédien comme on veut être chauffeur de taxi ou boulanger. On suit des cours, on fait des écoles, puis des conservatoires. C’est la différence essentielle – et il n’y a rien de péjoratif ici – entre Belmondo et Delon.
Je suis un acteur, Jean-Paul est un comédien. Un comédien joue, il passe des années à apprendre, alors que l’acteur vit. Moi, j’ai toujours vécu mes rôles. Je n’ai jamais joué. Un acteur est un accident. Je suis un accident. Ma vie est un accident. Ma carrière est un accident".
En effet, il arrive que comédien et acteur soient utilisés l’un pour l’autre, mais Alain Delon identifie une différence, en termes de motivation/vocation, apprentissage/incarnation, entre les deux termes.
On attribue également à Alain Delon la citation "La chance n’existe pas, ça s’appelle le destin", qui montre là aussi la distinction entre deux termes proches. Dans les deux cas (comédien/acteur, chance/destin), on peut presque trouver une forme de volontarisme dans le regard linguistique posé, puisque le hasard ou les circonstances sont mis à distance dans la valeur accordée aux mots.
"JE NE JOUE PAS, JE VIS": UNE SUBJECTIVITE RELATIVE
Les médias citent abondamment, depuis le décès de l’acteur, la phrase "Je ne suis pas un comédien: je ne joue pas, je vis". Cette citation peut donner l’impression d’une personne prétentieuse. En fait, dans l’entretien au Journal du Dimanche, qu’il a donné le 18 mai 2019, Alain Delon indiquait plus exactement:
"Je ne suis pas un comédien: je ne joue pas, je vis. Aujourd’hui, je suis différent d’hier physiquement. Mais je ne veux pas refaire du cinéma pour faire du cinéma. Je ne veux pas faire le combat de trop, comme disent les boxeurs, que je connais bien. J’ai vu ça chez Sugar Ray Robinson. Joe Louis aussi. Pour l’orgueil ou le pognon. Je n’ai pas envie de ça".